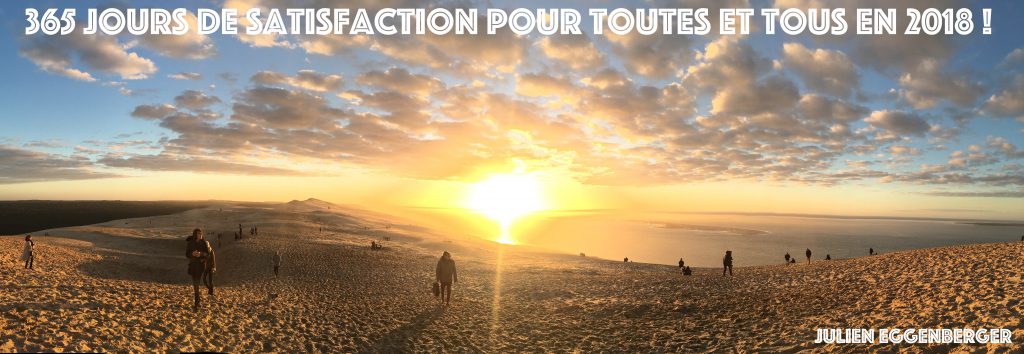VAUD . À nouveau, l’administration fiscale vaudoise se démarque pour sa propension à favoriser les plus aisés. Au détriment du service public et de l’ensemble de la population.
Article paru dans Services publics le 17 janvier 2020
En décembre dernier, la presse dévoilait un rapport du Contrôle fédéral des finances estimant que le canton de Vaud n’applique pas correctement les dispositifs légaux cadrant l’imposition à la dépense (forfait fiscal).
CHAMPION DES FORFAITS. Pour rappel, ce régime de superprivilégiés ne devrait s’appliquer qu’à des résidents étrangers qui n’ont aucune activité lucrative sur le territoire suisse. À l’origine, il devait permettre une imposition simplifiée des rentiers étrangers. Aujourd’hui, il permet à des très riches de payer un impôt sans rapport avec leurs moyens. Le canton de Vaud est le champion des forfaits fiscaux, puisqu’un quart de tous les bénéficiaires y résident.
PAS DE REVENU POUR PAULSEN? Le fisc vaudois considère qu’une participation non rémunérée à un conseil d’administration n’est pas une activité lucrative, y compris quand le contribuable concerné est un propriétaire important de l’entreprise. Cette pratique permet par exemple à Frederik Paulsen, propriétaire de la multinationale pharmaceutique Ferring, basée à St-Prex, de présider le conseil d’administration du groupe tout en bénéficiant d’un statut fiscal réservé à des personnes sans activités lucratives. L’analyse du Contrôle fédéral des finances s’appuie sur un rapport remis par la professeure de droit fiscal de l’Université de Zurich, Madeleine Simonek. Celle-ci estime que le président, même non rémunéré, d’une grande entreprise bénéficie de gains significatifs en capital et des dividendes des actions qu’il possède. Dès lors, il est hypocrite de prétendre qu’il ne réalise pas un revenu sur le territoire suisse. Interrogé par le quotidien 24 heures, le ministre vaudois des Finances, Pascal Broulis, conteste évidemment cette analyse [1].
EN MARGE DES RÈGLES. Cette situation est d’autant plus grave que les directeurs des Finances de tous les cantons s’étaient engagés à la plus grande rigueur lors de la campagne de votation de 2014. Un devoir de surveillance avait même été attribué à l’Administration fédérale des contributions, bien que celle-ci semble peu pressée de se saisir de cette mission. Ces engagements avaient convaincu une majorité de la population de rejeter l’interdiction des forfaits fiscaux. Il faut malheureusement constater que le canton de Vaud continue d’octroyer des faveurs en marge des règles légales, au détriment de l’égalité devant l’impôt et au prix de pertes considérables pour les collectivités publiques.
COCKTAIL DE DÉDUCTIONS. Le feuilleton des différentes réformes de la fiscalité des entreprises devait aboutir à l’élaboration d’un système transparent mettant fin aux statuts spéciaux et traitant toutes les entreprises sur un pied d’égalité. Dans le canton de Vaud, un taux d’imposition du bénéfice de 13,79% avait été défini, soit une diminution de 10% pour la plupart des entreprises – mais quelques points de plus pour les holdings et les multinationales. Cette opération représentait une perte de plusieurs centaines de millions de francs, ce que le SSP dénonçait avec vigueur. De son côté, la Confédération a inclus dans la réforme fiscale (RFFA) différents outils d’optimisation fiscale (exonération des revenus provenant des brevets, déduction des frais de recherche et de développement notamment). Les cantons avaient une marge de manœuvre pour reprendre, ou non, ces outils. Vaud, qui vient de communiquer son dispositif, a décidé d’en faire un large usage. D’après différents calculs, le taux effectif d’imposition du bénéfice sera inférieur à 11% [2]. À titre de comparaison, dans le canton de Genève, le taux effectif minimum est de 13,48%. À ce jour, ni les communes, ni le canton n’ont communiqué le coût de cette opération pour les finances publiques. Une situation d’autant plus choquante que, lorsque nous nous sommes opposés à la baisse du taux cantonal en 2016, on nous a répondu que le nouveau système serait équitable, transparent et permettrait de stabiliser les ressources fiscales. À aucun moment, il n’avait été question d’une multiplication des niches fiscales.
JUSQU’À L’ÉPUISEMENT. Comme si cela ne suffisait pas, les idées fusent pour continuer à améliorer l’attractivité fiscale pour les entreprises ou les contribuables aisés (suppression du droit de timbre, déductions supplémentaires pour les familles les plus favorisées). À ce jour, le canton de Vaud a réussi à absorber ces pertes fiscales au prix d’une gestion draconienne des dépenses publiques. Mais les communes, elles, se retrouvent sous pression. En janvier 2020, environ 60% des communes vaudoises connaîtront une hausse de l’impôt sur les personnes physiques (canton + commune). La tendance n’est pas près de s’arrêter.
Le résultat de cette politique en faveur des plus favorisés est donc clair: plans d’austérité, projets abandonnés et hausses d’impôts pour la plus grande partie de la population.
Contexte
UNE RÉFORME MONDIALE DE LA FISCALITÉ
Depuis des décennies, la Suisse pratique une stratégie de prédation fiscale visant à attirer des multinationales en leur garantissant une fiscalité attractive. Conséquence de cette stratégie, une fraction des profits réalisés à l’étranger est (très peu) taxée ici, privant les autres pays de ressources vitales.
Pour contrer cette concurrence déloyale, les autres nations ont obtenu que la Suisse supprime les statuts spéciaux et traite toutes les entreprises de la même manière. Cette réforme, intitulée « 3e réforme de l’imposition des entreprises » (RIE3), d’abord refusée par le peuple, puis reprise, sans grande modification, dans la Réforme fiscale et du financement de l’AVS (RFFA), a été acceptée l’an dernier. Son principe: baisser les taux pour toutes les entreprises en espérant ainsi garder les multinationales sur le sol helvétique.
Dans l’intervalle, l’OCDE a lancé un processus visant à harmoniser l’imposition des multinationales au niveau mondial. Ce projet vise à remplacer le principe de la taxation au siège social par celui d’une taxation dans les pays où les biens sont exportés et vendus, et où les bénéfices sont générés. Cette réforme devrait permettre de régler la difficulté à taxer les sociétés actives sur internet. L’évolution semble aller dans le bon sens. Elle mettra cependant la Suisse dans une situation compliquée et risque de provoquer une nouvelle chute des recette fiscales.
Tant que les autorités suisses raisonneront en termes d’attractivité fiscale, elles devront enchaîner les réformes et videront les caisses publiques. Et les mauvaises nouvelles pour la population et les services publics ne finiront pas de tomber !
[1] 24 heures, 19 décembre 2019.
[2] 24 heures, 7 janvier 2020.
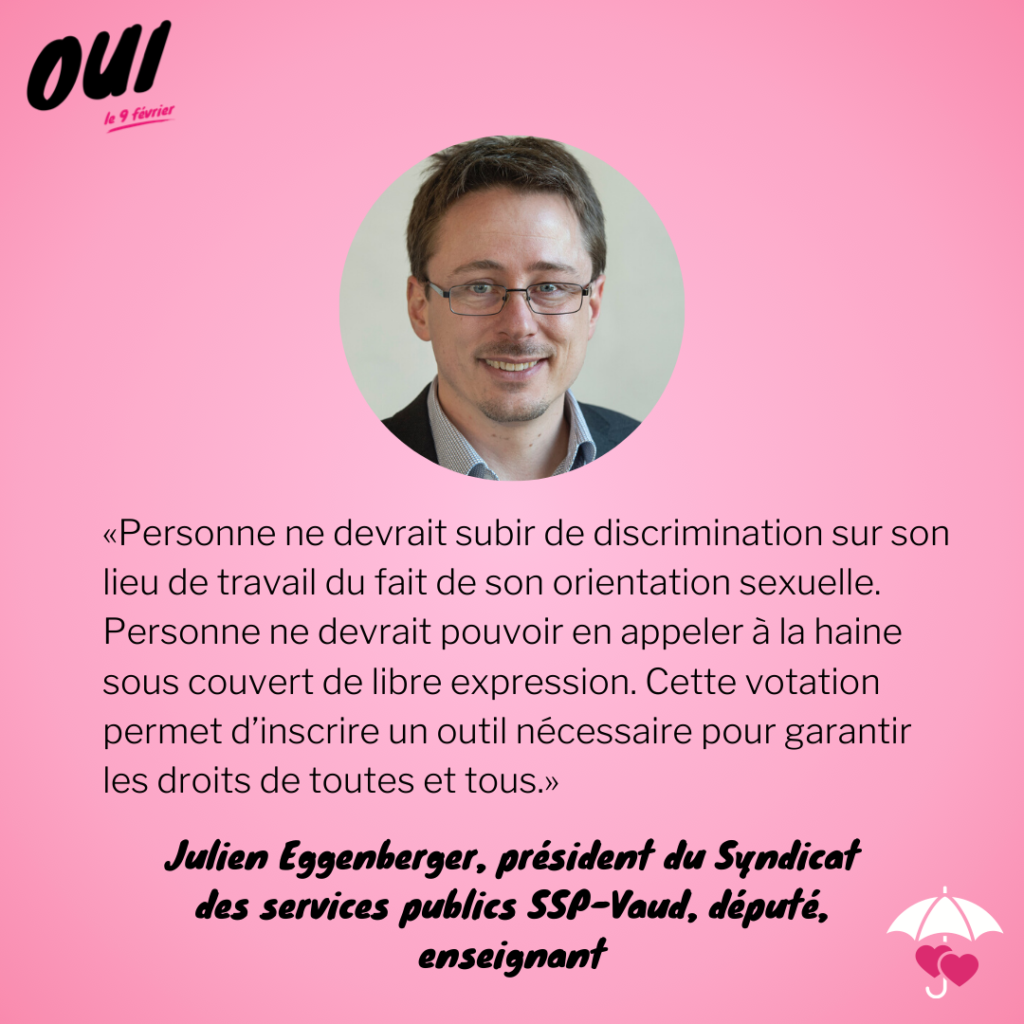

 De belles promesses…
De belles promesses…  La Maison du peuple est gérée par la coopérative du Cercle ouvrier lausannois. Créée en 1916, celle-ci a été fondée pour offrir aux organisations ouvrières un lieu de réunion et de culture à Lausanne. Près d’un siècle plus tard, le Cercle ouvrier lausannois est resté fidèle à sa vocation: la Maison du peuple est un lieu d’échange au coeur de la ville. En plus de logements, de bureaux et de commerces, la Maison du peuple abrite un restaurant, un bar, ainsi que des salles à disposition du monde associatif, syndical et politique.
La Maison du peuple est gérée par la coopérative du Cercle ouvrier lausannois. Créée en 1916, celle-ci a été fondée pour offrir aux organisations ouvrières un lieu de réunion et de culture à Lausanne. Près d’un siècle plus tard, le Cercle ouvrier lausannois est resté fidèle à sa vocation: la Maison du peuple est un lieu d’échange au coeur de la ville. En plus de logements, de bureaux et de commerces, la Maison du peuple abrite un restaurant, un bar, ainsi que des salles à disposition du monde associatif, syndical et politique.