Vaud Le Syndicat SSP pointe la dégradation des conditions de travail en 1 à 8P et demande notamment que l’aide à l’intégration des élèves souffrant de troubles soit renforcée.

L’usure guette les enseignants du primaire,selon le syndicat SSP. Image: KEYSTONE
«Depuis plusieurs années, la réalité du métier a évolué et les conditions de travail se sont dégradées dans les cycles primaires, lâche le président du SSP Vaud Julien Eggenberger, lui-même enseignant. Les retours du terrain sont unanimes. De plus en plus vite, ceux qui commencent le métier passent à temps partiel et de moins en moins veulent assurer une maîtrise de classe.» L’une des raisons importantes que soulève le SSP concerne la délicate question de l’intégration des élèves souffrant de troubles ou de handicaps. Ils ont des besoins particuliers et sont de moins en moins orientés dans des institutions parapubliques spécialisées. Le Canton de Vaud a rattrapé son retard dans le domaine de l’école inclusive, une philosophie qui n’est du reste pas critiquée dans son principe. Mais cette orientation a alourdi la barque pour les instituteurs et institutrices, souvent seuls au front.
Une gestion de classe compliquée
«Une fois qu’un problème est identifié vis-à-vis d’un élève, il n’est pas rare qu’il faille attendre un an voire plus avant d’obtenir une aide, témoigne Elise Glauser, enseignante de 1-2P sur la Riviera et membre de la direction du SSP Vaud. Pendant ce temps, il faut gérer une classe avec un enfant qui a un trouble aigu, c’est très compliqué.» Quand des professionnels entrent enfin en jeu (logopédistes, psychomotriciens, enseignants spécialisés, etc.) vient un autre casse-tête administratif. «L’Etat n’a pas anticipé l’énorme travail de coordinations entre les différents professionnels et les parents que doit assumer le maître de classe, reprend l’enseignante. On dit souvent que la pause de midi a disparu en primaire.»
Le SSP demande notamment qu’un dispositif de dépistage précoce des difficultés des élèves soit mis en place, que les délais pour faire un bilan et obtenir une aide de la part du Service de l’enseignement spécialisé (SESAF) soit grandement raccourci (lire encadré). Et qu’une campagne de recrutement et de promotion soit lancée pour la filière d’enseignement spécialisé: trop peu de personnes seraient formées pour répondre à la demande.
«Il y a en effet une tension entre l’expression des besoins et l’attribution des moyens»
Syndicat minoritaire dans les cycles primaires – où les enseignants sont davantage à être affiliés à la Société pédagogique vaudoise (SPV) –, le SSP Vaud frappe un grand coup pour marquer le terrain. Le contexte n’est pas anodin: une nouvelle conseillère d’Etat a pris en main cet été le Département de la formation. Et elle a les mains dans le cambouis avec l’élaboration du Règlement de la loi sur la pédagogie spécialisée. Un véritable pensum où chaque secteur professionnel défend son pré carré.
Cesla Amarelle ne nie pas les difficultés que rencontrent les enseignants du primaire. «Il y a en effet une tension entre l’expression des besoins et l’attribution des moyens. Pour les prestations de pédagogie spécialisée, et encore plus particulièrement pour l’intervention des logopédistes, psychomotriciens ou psychologues, il est donc nécessaire d’évaluer les demandes en termes de gravité et d’urgence. Ce qui peut générer une attente.» La ministre rappelle néanmoins que l’Etat s’est doté de moyens importants pour relever le défi de l’école inclusive: «Ces dix dernières années, le Département a engagé un nombre significatif d’enseignants spécialisés pour l’aide à l’intégration dans les établissements scolaires. Concernant la prise en charge des prestations de logopédie indépendante, le budget cantonal a augmenté de 60%», illustre-t-elle.
«Des principes à rediscuter»
L’avenir devrait en outre s’éclaircir avec l’entrée en vigueur, en août prochain, de la loi sur la pédagogie spécialisée (lire ci-contre). Plus généralement, la conseillère d’Etat n’exclut pas de rediscuter certains principes pour simplifier et accélérer le dispositif. «Il y a une réflexion à mener avec l’ensemble des acteurs, car les enseignants doivent être soutenus dans leur implication en faveur de l’intégration à l’école. Il faut aussi éviter que l’institution spécialisée soit perçue comme une sanction, alors que c’est un lieu très important pour que des élèves puissent se développer.» Cela dit, précise la socialiste, «le canton de Vaud est loin du tout intégratif». Le nombre d’élèves souffrant d’un trouble ou d’une déficience suivant le cursus dans une classe ordinaire est d’environ 1000, soit à peine plus de 1% des élèves de l’école obligatoire. Quelque 1500 autres sont en outre scolarisés ensemble dans des classes de développement et 1400 le sont dans des institutions de pédagogie spécialisées.
L’école inclusive n’explique pas seule l’usure que ressentent les profs, lit-on dans le rapport du SSP. «L’évolution du métier tient pour beaucoup à des facteurs extérieurs à l’école, d’ordre sociétaux. Ce ne sont plus les mêmes élèves, plus les mêmes parents qu’il y a trente ans», relève Julien Eggenberger. Même s’ils restent très minoritaires, de plus en plus d’enfants sans trouble particulier ont des problèmes de comportements à même de faire exploser la classe. La conseillère d’Etat a d’ailleurs annoncé cet été le lancement d’un projet-pilote socio-éducatif dans six établissements pour soulager le corps enseignant. (24 heures)
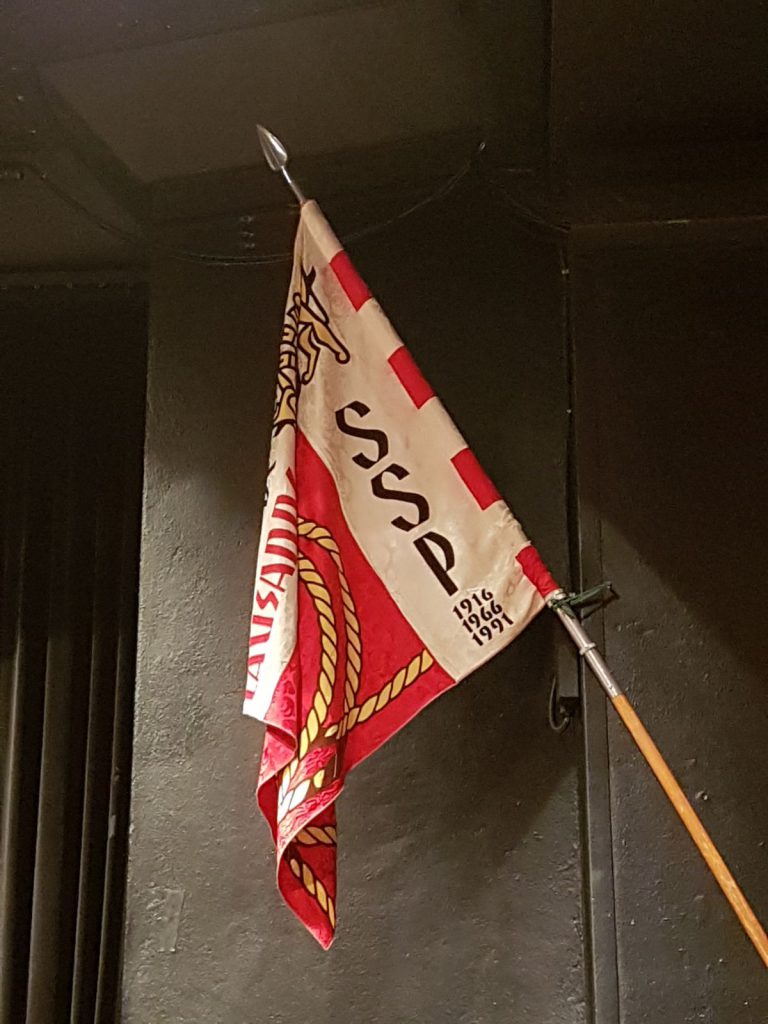 Chères et chers collègues,
Chères et chers collègues, Le 12 février, les citoyennes et citoyens sont appelés à se prononcer sur la troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIE3) suite au référendum déposé par une large alliance regroupant des partis politiques, des organisations syndicales et des associations. Si une bonne partie de la RIE 3 n’est pas transparente, voire délibérément opaque, une chose est claire : les conséquences financières d’une acceptation de cette réforme seraient gigantesques. C’est le message qu’entend porter l’alliance vaudoise NON à la RIE3 qui regroupe de nombreuses organisations (voir liste en fin de communiqué).
Le 12 février, les citoyennes et citoyens sont appelés à se prononcer sur la troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIE3) suite au référendum déposé par une large alliance regroupant des partis politiques, des organisations syndicales et des associations. Si une bonne partie de la RIE 3 n’est pas transparente, voire délibérément opaque, une chose est claire : les conséquences financières d’une acceptation de cette réforme seraient gigantesques. C’est le message qu’entend porter l’alliance vaudoise NON à la RIE3 qui regroupe de nombreuses organisations (voir liste en fin de communiqué).