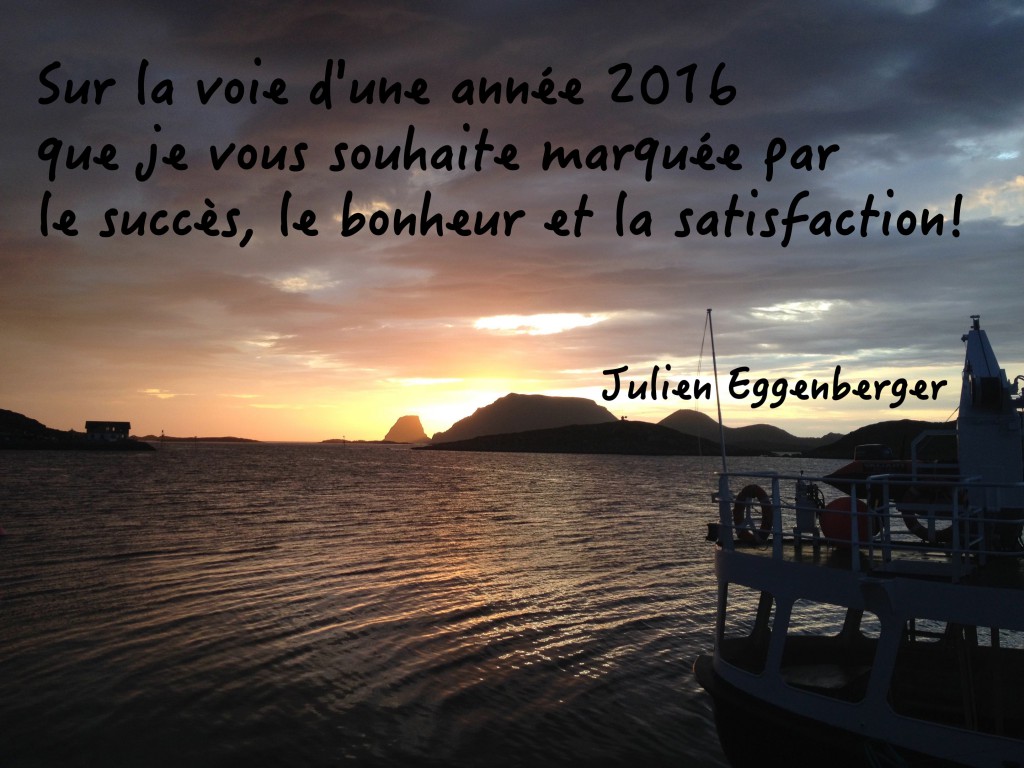
Auteur/autrice : jeggenbe
L’encadrement pour les mineurs non-accompagnés relevant du droit d’asile est-il adapté ?
Interpellation déposée le 15 décembre 2015
La situation internationale a mis sur les chemins de l’asile de nombreux réfugiés et réfugiées. Certains d’entre eux sont mineurs et voyagent seuls. Le canton de Vaud, par l’intermédiaire de l’EVAM, a mis sur pied des structures particulières pour celles et ceux que la Confédération confie à notre canton et qui ont plus de 14 ans. Il assure aussi la scolarisation de ceux-ci conformément aux principes fondamentaux des droits humains et au mandat public de formation.
L’augmentation importante des arrivées de mineurs non-accompagnés ces derniers mois a nécessité l’ouverture de nouveaux centres et de trouver des solutions permettant d’assurer leur scolarisation. Ces ouvertures récentes sont évidemment un défi qui nécessite de trouver des locaux adaptés et l’engagement de personnel qualifié. Elles obligent aussi les communes territoriales à trouver des locaux d’enseignement et les directions d’établissement à mettre sur pied dans des délais très rapides des classes d’accueil.
Malgré tous ces efforts, il apparaît que l’encadrement pose des difficultés importantes. Pendant plusieurs semaines, aucun personnel éducatif n’était présent les week ends. Par ailleurs, l’application automatique des normes définies par le Conseil d’Etat, notamment pour les repas, les vêtements et les loisirs, laisse les jeunes concernés seuls face à des problèmes quotidiens qu’un enfant de cet âge est bien en peine de résoudre. Ainsi, est-il raisonnable de demander à un jeune de 14 ans de gérer ses repas ? De plus, la coordination avec les établissements scolaires est difficile et de nombreuses zones grises subsistent. Est-ce vraiment le rôle des enseignant-e-s de l‘école obligatoire de fournir des sacs d’école et des habits chauds ?
En résumé, le concept d’encadrement comporte des lacunes et ne répond pas à ce qui est attendu dans le cadre de l’accueil de jeunes mineurs non-accompagnés relevant du droit d’asile.
Fort de ces constats, j’ai le plaisir de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :
- Dans le cadre de la convention de subventionnement de l’EVAM, quel encadrement et quels principes éducatifs sont définis ?
- Quel est l’encadrement éducatif prévu dans les différentes structures accueillant des mineurs non-accompagnés ? La présence d’un encadrant est-elle garantie 24/24h et 7/7j ? Quelles sont les qualifications des encadrant-e-s ?
- Comment les repas sont-ils organisés ?
- Tous les mineurs en âge de scolarité sont-ils scolarisés ?
- Quelle formation est proposée pour ceux qui n’ont plus l’âge d’être scolarisés ?
- Comment les communes et les établissements scolaires sont-ils associés à la prise en charge de ces jeunes ?
- Plus particulièrement, comment le financement des habits et des activités extra-scolaires est-il assuré ?
Je remercie d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses.
Julien Eggenberger, député PS
La fronde des profs fait plier l’Etat de Vaud
![]() Article dans Le Courrier du 28 novembre 2015 – Mario Togni
Article dans Le Courrier du 28 novembre 2015 – Mario Togni
PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE • Pour des «raisons budgétaires», le département de la formation avait gelé toute nouvelle mesure de soutien aux élèves handicapés en classe. Face au tollé des profs, il a annulé sa décision.
C’est ce qu’on appelle un rétropédalage en bonne et due forme. Le 18 novembre, l’Etat de Vaud décidait de geler toute nouvelle mesure de soutien aux élèves à besoins particuliers dans les classes ordinaires, pour des «raisons budgétaires». Une lettre du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (Sesaf ) en informait les établissements de la scolarité obligatoire. Jeudi, face au tollé provoqué par cette décision, le canton est revenu en arrière.
«Au vu des réactions provoquées et avec l’accord de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (Anne-Catherine Lyon, ndlr), j’ai décidé d’annuler cette mesure», confirme Serge Loutan, chef du Sesaf. Un nouveau courrier a été adressé le jour même aux directions d’établissements scolaires. «Nous allons donc continuer à étudier les demandes qui nous sont adressées», précise le chef de service.
Il rappelle que le budget 2016 de l’Etat de Vaud, sur lequel le Grand Conseil doit se prononcer prochainement, prévoit des augmentations de ressources pour la pédagogie spécialisée, avec notamment 18 postes supplémentaires d’enseignants spécialisés. Une partie de ces effectifs (10 postes) concernent la régularisation d’engagements déjà effectués à titre de renfort. «Cela permettra de répondre, au moins en partie, à l’augmentation de la demande», estime-t-il.
Soutien pédagogique
De quoi parle-t-on? L’intégration des enfants en situation de handicap à l’école nécessite notamment un soutien pédagogique (enseignants spécialisés) et des aides à l’enseignant, soit des personnes qui accompagnent les élèves dans les gestes du quotidien. Ces mesures sont décidées sur la base d’une longue procédure et avec l’appui de spécialistes. La nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée, qui doit entrer en vigueur progressivement dès la rentrée 2016, renforcera encore ce dispositif au cœur du concept d’école inclusive.
Or déjà aujourd’hui les besoins dépassent les moyens à disposition, d’où le moratoire décidé en novembre. Le Sesaf justifiait ce choix en soulignant que «l’accroissement des demandes dépasse toutes les prévisions budgétaires», en moyenne de 6% sur l’ensemble du canton. Toute nouvelle mesure de soutien serait donc refusée «par principe», écrivait-il, sans préciser jusqu’à quand.
Enseignants choqués
Stupeur chez les enseignants! «Nous sommes choqués et scandalisés par cette décision qui touche les élèves les plus fragiles», réagissait jeudi matin Grégory Durand, président de la Société pédagogique vaudoise (SPV), assurant que son téléphone était submergé d’appels de profs en colère et inquiets. La SPV et le Syndicat des services publics (SSP Vaud) ont donc écrit cette semaine au DFJC, demandant de suspendre cette décision «brutale» et «inacceptable».
Ils ont finalement été entendus. Dans son courrier de jeudi, Serge Loutan indique qu’il était dans son «devoir» de tirer les conséquences d’un dépassement quasi certain du budget pour l’année 2015. «L’objectif était principalement d’attirer votre attention sur ce risque et de permettre de l’évaluer», ajoute-t-il, à l’adresse des directeurs d’établissements. En leur demandant de rester «attentifs au risque élevé dans l’évaluation des situations nouvelles».
Elèves handicapés
Julien Eggenberger, président du SSP Vaud se dit «satisfait» de ce retournement de situation. «Nous sommes néanmoins effarés qu’une telle idée ait simplement été émise. C’est comme si le CHUV décidait de ne plus donner de médicaments à ses patients car l’enveloppe annuelle était épuisée! On parle ici d’élèves handicapés, par exemple des autistes, qui nécessitent parfois un accompagnement lourd, pas de simples appuis scolaires.»
Après cet épisode «inquiétant», le syndicat va demander au plus vite une rencontre avec la direction du Sesaf et Anne-Catherine Lyon. «Nous voulons des garanties pour la suite», souligne Julien Eggenberger. En particulier, la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée, qui nécessitera des moyens supplémentaires, n’a pas de quoi rassurer dans ce contexte. «Une certaine méfiance s’est installée, nous allons être très vigilants», conclut le syndicaliste.
A l’école, parler des attentats est délicat mais nécessaire
 Article du Courrier – 17 novembre 2015 – Mario Togni
Article du Courrier – 17 novembre 2015 – Mario Togni
Faut-il parler des attentats de ce week-end à l’école? Si oui, comment les aborder? Autant de questions que les enseignants vaudois, comme les autres, se sont posées à l’heure de reprendre les cours hier matin. Lorsque de tels événements se produisent, le malaise n’est jamais loin. Beaucoup de profs abordent néanmoins spontanément le sujet avec leur élèves.
C’est le cas de Julien Eggenberger, enseignant au Secondaire à Lausanne et président du SSP-Vaud. «J’en ai discuté avec mes classes ce lundi matin, témoigne-t-il. Les élèves étaient très au courant, lucides mais aussi inquiets.» Pour lui, il est essentiel de répondre à leurs questionnements et sentiments. «La peur est légitime, il faut la saisir, la comprendre et la dépasser.»
Lui a choisi d’afficher l’image de Marianne en pleurs, largement diffusée sur les réseaux sociaux, comme point de départ de la discussion. «Le débat s’est fait tout seul, les élèves avaient beaucoup de choses à dire. Notre rôle est de donner du sens à ces événements, de les mettre en perspective, d’offrir des clés de lecture.» Parmi ses collègues, la plupart ont aussi passé une partie de la matinée à évoquer l’actualité parisienne.
Des élèves «surinformés»
Le Syndicat des services publics et la Société pédagogique vaudoise (SPV) ont d’ailleurs diffusé dès dimanche sur internet des articles et documents utiles pour aborder les attentats en classe. «Le but n’est pas de noyer les enseignants d’informations mais de leur donner quelques pistes», souligne Grégory Durand, président de la SPV. «Les élèves arrivent en classe surinformés par la télé, les journaux, les discussions en famille, les réseaux sociaux. Pour les profs, la difficulté est de cadrer ces informations et de gérer l’aspect émotionnel.»
C’est que beaucoup d’enseignants se sentent «démunis», souligne Alain Pache, professeur en didactique des sciences humaines et sociales à la Haute école pédagogique (HEP-Vaud): «L’enseignant doit déjà se sortir de sa propre stupeur. Certains doutent d’être capables de faire face à l’émotion, d’avoir suffisamment de recul ou craignent les propos tendancieux.» Selon lui, les ressources pédagogiques manquent dans le canton de Vaud, à l’inverse de la France où il existe des plateformes d’information efficaces destinées aux enseignants.
Offrir un espace de parole
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) ne donne en effet pas de directive ni ne met de matériel à disposition, confirme Michael Fiaux, délégué à la communication. «Le choix de parler de tels événements en classe est laissé au libre arbitre des enseignants. S’ils le font, il doivent en revanche privilégier la mise en perspective et la distanciation, tout en offrant une globalité de points de vue», précise-t-il.
La HEP livre de son côté quelques recommandations. «En premier lieu, il est nécessaire d’offrir un espace de parole, de permettre aux élèves de mettre des mots sur un phénomène, de revenir aux faits», illustre Alain Pache. «Qu’est-ce qu’un terroriste? Quelles sont ses motivations? Qu’est-ce que l’état d’urgence en France?» Répondre à ce type de questions permet, selon lui, de prendre de la distance. Pour les plus petits, l’outil du dessin est aussi parfois utilisé.
Dans un second temps, les enseignants peuvent revenir sur le sujet dans le cadre de disciplines spécifiques, ajoute le spécialiste. Les sciences humaines et sociales (géographie, histoire, citoyenneté, éthique et cultures religieuses), sont particulièrement adaptées. «Cela permet, par exemple, de travailler sur les valeurs d’un État de droit, sur les sources d’informations, ou encore sur les amalgames», conclut-il.
Sélection de sites proposée par le SSP-Enseignement contenant des documents utiles pour aborder en classe les tristes événements duweek end:
– Education nationale française: « Comment aborder la question au primaire et au secondaire »:
http://eduscol.education.fr/…/savoir-accueillir-la-parole-d…
– Les Cahiers pédagogiques: « Des ressources pour parler avec les enfants »:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-ressources-pour-par…
– La Passerelle Histoire/géographie: « Par qui notre liberté est-elle menacée? »
http://lewebpedagogique.com/…/emc-4eme3eme-par-qui-notre-l…/
– Bayard Presse: « Les enfants ont besoin de connaître les mots des grands! »:
http://www.bayard-jeunesse.com/…/Les-enfants-ont-besoin-de-…
– L’Express: « Comment éviter que les enfants aient peur du terrorisme?:
http://www.lexpress.fr/…/terrorisme-comment-eviter-que-les-…
Discours de bienvenue au Congrès fédératif du SSP 2015
Chères et chers collègues, la situation des salarié-e-s dans notre pays est sous pression. Attaque sur les retraites, dumping dans les zones frontalières ! Durcissement du patronat ! Austérité et concurrence fiscale mettant en difficulté les services publics et leurs salariés et salariées ! Stigmatisation des migrantes et migrants ! Accueil des réfugiés et réfugiées remis en cause ! Les élections fédérales du mois dernier laissent penser que ces tendances ne vont pas s’inverser, mais au contraire se durcir ! Le syndicat est la seule arme aux mains des salariées et des salariés. C’est donc avec engagement et conviction que j’ai le plaisir d’accueillir ici les déléguées et délégués du 47è congrès du SSP, ici à Lausanne. C’est aussi le premier congrès de la nouvelle région Vaud, réunissant les anciennes régions Vaud et Lausanne et environs.
Chères et chers collègues, nos autorités fédérales ont décidé, sous prétexte d’une pression internationale, de procéder à une vaste opération d’escroquerie fiscale, offrant des milliards de cadeaux fiscaux. L’année prochaine, notre fédération devra prendre ses responsabilités afin de défendre les ressources du service public en nous opposant à la troisième réforme de l’imposition des entreprises.
Une imposition juste est la base d’un État démocratique veillant à offrir des services publics universels et à redistribuer les richesses. À l’inverse, la concurrence fiscale n’est qu’une attaque directe contre notre démocratie. Elle menace la participation de chacune et chacun à ce système et met en péril des services nécessaires, comme l’éducation, la santé ou les retraites. De l’OCDE au Conseil fédéral, toutes les élites dirigeantes se frottent les mains à l’idée de renforcer l’attractivité fiscale de la Suisse, objectif clairement explicité et assumé. Objectif au profit des grandes entreprises et de leurs actionnaires. Objectif au détriment de la population.
Le canton de Vaud, comme de nombreuses collectivités publiques suisses, a une histoire faite de politiques d’austérité, austérité qui est le fruit des précédentes baisses fiscales et dont la conséquence a été une dégradation d’ampleur des services publics. En plus de ce critère quantitatif, les conditions de travail et la qualité des prestations à la population se sont nettement détériorées. Le syndicat est bien placé pour en témoigner ! Des détériorations dues à l’augmentation de la complexité des prises en charge dans de nombreux secteurs et à l’augmentation rapide de la population, une des plus rapides de Suisse. Cette situation ne sera qu’aggravée par cette politique de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Il y quelques semaines, sur proposition du Conseil d’Etat, le Grand Conseil du canton de Vaud décidait d’anticiper la réforme en première suisse. Il vient donc d’adopter une baisse massive de l’imposition des entreprises. Pour éviter de condamner le service public au sous-développement, la région Vaud du SSP s’est engagée avec vigueur à combattre ce projet par référendum, dans le cadre d’une coalition de partis, de syndicats et d’ONG.
Nous le savons trop bien, de nombreux exemples le prouvent dans l’histoire récente de la Suisse, ces réformes auront des conséquences fâcheuses sur les ressources fiscales des communes, des cantons et de la confédération. A chaque fois, les perdants sont les salariées et les salariés ainsi que les usagers et usagères du service public.
Chers et chères collègues, nous sommes face à une attaque massive contre les services publics fédéraux, cantonaux et communaux. Attaque en faveur d’une poignée de grosses entreprises bénéficiaires, au détriment de toutes les personnes usagères des services publics, c’est-à-dire nous toutes et tous. Notre responsabilité est grande, à nous d’y faire face ! Nous voulons briser un processus qui semble inéluctable. Nous voulons montrer au contraire que nous restons prêts à défendre l’égalité et la solidarité. Nous voulons que cette réforme soit ce qu’elle aurait dû être : la fin des statuts spéciaux, la fin de la spirale destructrice de la concurrence fiscale et non pas la fin des services publics.
Le mouvement syndical est devant ses responsabilités ! A nous de prendre les nôtres ! Nous vous souhaitons un congrès que nous espérons combatif et déterminé !
Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen. Wilkommen in Lausanne. Heute wird in der ganzen Schweiz die Situation der Angestellten stark angegriffen. Der Ständerat hat am sechsten September über die « Altersvorsorge 20 20 » abgestimmt. Leichten Erhöhungen bei den AHV-Neurenten stehen inakzeptable Verschlechterungen gegenüber : Die Erhöhung des Frauenrentenalters und den massiven Rentenklau bei der zweiten Säule lehnt die Gewerkschaft klar ab. Wir wollen eine würdige Atersvorsorge für alle und wir werden dafür kämpfen.
Die Gewerkschaftsbewegung muss ihrer Verantwortung gerecht werden! Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen! Wir wünschen euch einen guten Kongress und hoffen, dass er kämpferisch und entschlossen wird!
Care colleghe, Cari colleghi, Benvenute e benvenuti a Losanna,
La concorrenza internazionale nel mercato del lavoro mette a repentaglio le condizioni di lavoro dei dipendenti. Dobbiamo lottare per rafforzare le leggi e i controlli sul lavoro. Noi non facciamo ingannare: sono i padroni che traggono profitto dalla situazione contrariamente a ciò che sta cercando di dire la destra nazionalista. Difendiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. I nostri nemici sono i padroni, non gli stranieri!
Il movimento sindacale fa fronte alle sue responsabilità! Spetta a noi assumerci le nostre! Vi auguriamo un congresso che speriamo combattivo e determinato!
Aide d’urgence : il est urgent de prendre la mesure des problèmes!
Interpellation déposée au Grand Conseil du canton de Vaud le 29 septembre 2015
L’actualité internationale met en lumière la situation des requérants d’asile et des réfugié-e-s et de l’aide qui doit leur être apportée. Le système de l’aide d’urgence devait permettre de prendre en charge des situations pour quelques semaines. Le bilan est sévère : de nombreuses personnes sont au bénéfice de ce régime depuis de nombreuses années, alors que, pour des raisons relevant du droit humanitaire, elles ne peuvent être renvoyées dans leur pays d’origine.
Dans le canton de Vaud, l’aide d’urgence est destinée aux personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, aux détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée (livret L) et aux requérants d’asile déboutés pour lesquels l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi (Directives du DECS concernant l’assistance dans le domaine de l’asile). Elle consiste en une aide minimale dont le contenu est défini par l’article 4a de la Loi sur l’action sociale vaudoise.
La situation dramatique que connaissent les migrant-e-s qui dorment dans les jardins et dans les rues ou occupent illégalement des locaux appartenant à des collectivités publiques interpelle. Cette situation donne l’impression que le SPOP ne met pas tout en œuvre afin de remplir le mandat légal défini par la Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA art. 49) et visant à assurer une aide d’urgence afin de garantir que les bases élémentaires assurant les conditions d’accueil et le principe de dignité (Constitution fédérale art.12) soient respectés (hygiène, logement, alimentation). Les modalités d’attribution de cette prestation montrent des limites et de nombreuses personnes qui pourraient y prétendre se tournent vers les prestations sociales d’hébergement d’urgence. Une des raisons invoquées est la crainte de venir dans les locaux du SPOP.
Cette situation qui devait être provisoire perdure et continue à poser des problèmes, en particulier parce qu’elle entraîne la fragilisation des mesures d’assistance médicale. Ce qui peut être considéré comme tolérable, normal ou encore logique en cas de catastrophe naturelle ou d’incendie, c’est-à-dire un dépannage à court terme, ne peut être une mesure pérenne destinée à durer des semaines, des mois ou des années.
Au vu de ces différents constats, nous posons au Conseil d’Etat les questions suivantes :
- Le système d’aide d’urgence mis sur pied par le SPOP permet-il de remplir durablement les obligations légales visant à assurer à toute personne en état de nécessité une aide d’urgence ?
- Quelle est la durée moyenne d’utilisation des prestations d’aide d’urgence sur l’ensemble des bénéficiaires ? Et par quartile ?
- Que fait l’Etat lorsque le recours à l’aide d’urgence dépasse 5 ans ? A partir de 10 ans au régime d’aide d’urgence, ne faut-il pas considérer que les modalités dissuasives ont échoué et qu’il faut trouver d’autres modalités pour faire respecter le principe de dignité consacré à l’article 12 de la Constitution ?
- Les structures d’hébergement d’urgence sont-elles utilisées en lieu et place des prestations fournies par le SPOP ? Si oui, pour quelles raisons ? Quel est le coût assumé par les communes via la facture sociale ?
- La procédure d’inscription dans les locaux du SPOP constitue-t-elle un obstacle qui retient les personnes de solliciter l’aide d’urgence ?
- D’autres modalités d’octroi de l’aide d’urgence, par exemple par l’intermédiaire d’une organisation mandatée par l’Etat, ont-elles été étudiées ? Une pratique plus adaptée ne permettrait-elle pas d’éviter les situations découlant d’occupations illégales ?
Nous remercions d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses.
Julien Eggenberger, député PS
Quelles mesures pour assurer des conditions élémentaires d’accueil dans le canton?
Question orale déposée au Grand Conseil le 1 septembre 2015.
Vu la situation dramatique que connaissent les migrant-e-s actuellement obligés de dormir dans les jardins et dans les rues et au vu du constat que l’accueil des requérant-e-s d’asile débout-é-s à l’aide d’urgence est de compétence cantonale (LARA art. 49), quelles sont les mesures urgentes prises ou prévues par le SPOP afin de garantir que les bases élémentaires assurant les conditions d’accueil et le principe de dignité (Constitution fédérale art.12) soient respectés (hygiène, logement, alimentation)?
Ramadan: elle refuse aux profs de réhydrater sa fille
![]() Article 20 Minutes – Mirko Martino
Article 20 Minutes – Mirko Martino
Des maîtres ont dû recourir à un imam pour faire boire une élève mal en point. Les musulmans romands en appellent au bon sens.
A la fin juin, une écolière s’est sentie mal pendant une activité en plein air avec sa classe. Les maîtres ont tenté de lui donner de l’eau, mais la fillette a refusé: elle ne voulait pas faire une entorse au jeûne du ramadan. Les adultes ont alors appelé la mère de l’enfant. Elle aussi a répondu par la négative. Ils ont finalement dû faire appel à un imam pour faire boire l’élève.
Cette mésaventure fait bondir Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation de l’Entre-connaissance. «C’est une aberration, s’indigne-t-il. Cette mère est une ignorante! Le ramadan se fait à partir de la puberté. Et rien n’y oblige: chacun doit le sentir en lui.» Grégory Stergiou, président de la Fondation islamique de Vevey, précise qu’«en cas de maladie, on peut rompre le jeûne et on le rattrape plus tard, sans que cela annule le ramadan».
Pascal Gemperli, président de l’Union vaudoise des associations musulmanes, explique qu’il est aussi du rôle des parents d’enseigner le jeûne: «On peut commencer par le faire quelques jours, pour s’y habituer progressivement.» Du côté médical, «l’organisme ne peut pas tenir sans eau, rappelle Olivier Duperrex, responsable de la promotion de la santé en milieu scolaire. Avec cette chaleur, un adulte adapte son rythme, mais pas un enfant. Alors il doit boire.»
Hafid Ouardiri saisit l’occasion pour répéter le message de sa fondation: «Cela démontre que l’on doit travailler ensemble pour que l’ignorance disparaisse. Et qu’elle ne mette plus en danger la vie d’un être humain au nom de la religion.»
«Hotline» pendant le défilé des élèves
Cette mésaventure a poussé le service des écoles à se prémunir pour le cortège des enfants du primaire, mercredi dernier. Son chef, Philippe Martinet, a ainsi contacté un imam. Celui-ci s’est tenu à disposition téléphonique durant toute la manifestation pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. «Au final, nous n’avons pas eu besoin de faire appel à ses services, précise Philippe Martinet. Mais cette démarche s’inscrit dans notre volonté de développer le «vivre ensemble» de manière pragmatique entre les plus de 110 nationalités que compte Lausanne».
«Il me semble qu’un prof peut l’y obliger»
«Les enseignants sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour préserver l’intégrité physique d’un élève, rappelle Julien Eggenberger, du comité SSP-Enseignement. En cas d’évanouissement, il est de leur responsabilité d’alerter le service de santé, une ambulance ou les parents pour qu’ils viennent immédiatement. Si l’enfant refuse de boire alors que sa santé est en jeu, il me semble qu’un professeur peut l’y obliger. De plus, les services médicaux et la protection de la jeunesse sont compétents pour prendre toutes mesures permettant de protéger un mineur, y compris contre l’avis de ses parents.»
Vennes FM
Découvrez Vennes FM, fruit du travail des élèves de 10VG1 de l’EPS Isabelle-de-Montolieu (Lausanne) sur les ondes de Radiobus!
Les émissions sur le blog:
http://www.radiobus.fm/podcast/1010fm-lausanne-isabelle-de-montolieu
Initiative cantonale visant à donner aux autorités communales un droit de regard sur l’organisation des points d’accès au réseau postal
Initiative déposée le 2 Juin 2015
Ces dernières années, de nombreuses fermetures d’offices de poste ont été décidées de manière unilatérale par La Poste. Celles-ci ont fait l’objet de nombreuses interventions au Grand Conseil, par exemple en 2009, l’interpellation Nicolas Rochat (09_INT_229) sur l’analyse des quarante-huit offices de poste menacés, par la question de la députée Delphine Probst (13_HQU_100) sur la situation des offices dans le Gros-de-Vaud ou encore l’interpellation Marc Oran (13_INT_155) et en réponse de laquelle le Conseil d’Etat mentionnait qu’il userait de toute sa marge de manœuvre en cas de désaccord et finalement l’interpellation Julien Eggenberger (15_INT_351) qui questionnait le Conseil d’Etat suite à de nouvelles annonces de fermetures.
A de nombreuses occasions, les habitant-e-s et les autorités communales se sont engagés pour maintenir des offices de poste.
A chaque fois, La Poste a consulté pour la forme les autorités communales mais sans réellement tenir compte de leur avis. Or les autorités communales sont les instances démocratiques légitimes les plus à même à évaluer les besoins de la population et leurs évolutions. Aujourd’hui, La Poste est donc à la fois l’entité organisatrice de son réseau et l’autorité qui statue sur les éventuels recours. Dans ce cadre, le fait que la législation sur la poste (Loi sur la poste art. 15 et Ordonnance sur la poste art. 34) donne cette compétence décisionnelle à La Poste met en échec toute possibilité d’agir contre des opérations d’optimisation financière visant à augmenter le bénéfice de l’entreprise publique au détriment des usager-ère-s des services postaux.
Finalement, les autorités communales sont les mieux placées pour évaluer si une prestation doit être modifiée, améliorée ou regroupée. Pour pouvoir leur donner un rôle actif sur cette question, une modification de la législation fédérale est nécessaire. Elle doit permettre de garantir la desserte postale comme service public garanti par la législation.
Au vu de ces différents constats, il apparaît nécessaire de modifier la procédure définissant la structure du réseau postal et c’est pourquoi nous proposons par voie d’initiative cantonale à l’intention de l’Assemblée fédérale que la législation prévoie qu’une modification du réseau postal doive être soumise pour accord aux autorités communales concernées.
Dépôt au Grand Conseil du 2 juin 2015
Julien Eggenberger
Olivier Golaz
Raphaël Mahaim
Martine Meldem
Jérôme Christen
Christiane Jaquet-Berger