Motion déposée au Grand Conseil du canton de Vaud le 2 mars 2021
Un homme homosexuel menacé de mort pour qu’il épouse une femme et ait des enfants. Une femme lesbienne à qui on fait subir des séances d’hypnose comportant des messages à caractère sexuel visant à habituer son corps à la pénétration masculine. Un traitement psychique pour « guérir » la transidentité. Des exorcismes visant à « chasser le démon de l’homosexualité », des sévices sexuels, des viols, des traitements hormonaux, des électrochocs, l’excision de femmes lesbiennes… ou encore, plus couramment aujourd’hui, des « thérapies » visant à restaurer une identité conforme à la norme hétérosexuelle et cisgenre, ou à défaut à fournir un accompagnement vers une « vie chaste et normative ». Parmi elles, la thérapie par aversion qui consiste à soumettre une personne à des sensations négatives, douloureuses ou angoissantes alors qu’elle est exposée à un certain stimulus lié à son orientation affective et sexuelle et/ou à son identité de genre. Autant de pratiques prétendant changer l’orientation affective et sexuelle et/ou l’identité de genre d’une personne. Elles n’atteignent jamais l’effet escompté et détruisent la vie psychique et sexuelle des personnes qui en sont la cible. Par simplification, l’usage nomme ces pratiques « thérapies de conversion », bien qu’elles n’y ressemblent que rarement.
Trois approches extrêmes fondent les thérapies de conversion : psychothérapeutiques (la diversité sexuelle ou de genre découle d’une éducation ou d’une expérience anormale), médicales (orientation affective et sexuelle et l’identité de genre sont la conséquence d’un dysfonctionnement biologique) et confessionnelles (les orientations affectives et sexuelles et les identités de genre différentes ont quelque chose de fondamentalement mauvais et « contre nature »).
Un rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU[1] assimile les « thérapies de conversion » à des actes de torture et appelle à leur interdiction. Ces pratiques sont « intrinsèquement discriminatoires, cruelles, inhumaines et dégradantes et selon la sévérité de ces pratiques, de la souffrance, de la douleur physique ou mentale qu’elles infligent à la victime, elles peuvent être assimilées à des actes de torture. » Elles partent du principe que les personnes d’orientation affectives et sexuelle diverse ou d’identité de genre variante seraient déviantes et inférieures, sur le plan moral, spirituel ou physique, et devraient donc changer leur orientation ou leur identité pour y remédier.
Parmi les conséquences délétères de ces thérapies, on peut relever[2] un dégoût de soi et de son orientation sexuelle et affective, de l’anxiété, une dépression avec des idées suicidaires, des troubles sévères de la sexualité, un échec scolaire pour les adolescents, des situations conjugales extrêmement douloureuses lorsque la personne est encouragée à former un couple hétérosexuel et/ou contrainte à se marier. Ces pratiques sont d’une extrême violence et ne sauraient entrer dans le cadre de la liberté d’expression ou dans celle de la liberté de conscience et de religion tant qu’elles induisent de la souffrance. Elles enfreignent les droits de l’enfant lorsqu’elles sont imposées par les parents et dépossèdent la personne, alors vue comme une patiente, de son libre arbitre et de son consentement.
La situation est d’autant plus grave pour les mineurs qui sont en droit d’attendre de la protection et une attitude bienveillante de la part des adultes garant de leur développement et non pas une remise en cause de leur identité.
En Europe, depuis le début des années 2000, apparaissent, sous l’impulsion d’associations chrétiennes intégristes, des programmes de conversion. Suite aux mesures prises en Allemagne (interdiction des thérapies de conversion pour les mineurs), les principales organisations les pratiquant ont quitté ce pays pour s’établir en Suisse. Ainsi, et par exemple, la Bruderschaft des Weges (« Confrérie du Chemin ») et l’Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung (« Institut de pastorale et de conseil pour la restauration identitaire par le dialogue ») ont annoncé leur enregistrement en tant qu’association suisse au premier semestre 2020[3].
La Suisse est donc particulièrement concernée. D’une part, les programmes à vocation religieuse[4], y compris dans le canton de Vaud (par exemple, l’Église évangélique Lazare de Bussigny qui proposait des cours de « restauration de l’identité » [5]). D’autre part, des personnes agissant dans le domaine thérapeutique ou médical : c’est, par exemple, le cas avec l’information communiquée début juillet 2020 d’un psychiatre du canton de Schwyz qui a fait reconnaître des thérapies de conversion comme psychothérapie médicale et donc payées par l’assurance maladie. On se rappelle aussi la révélation, en 2018, d’un médecin et homéopathe pratiquant dans les cantons de Genève et de Vaud et qui proposait de « guérir de l’homosexualité ».[6] Dans la situation juridique actuelle, il semble qu’il n’y a pas de sanctions possibles à l’encontre de ces médecins, que ce soit une amende ou même une interdiction professionnelle, bien qu’ils aient violé l’éthique professionnelle. Ces cas ne sont pas isolés, puisqu’on estime que 14 000 personnes en Suisse sont concernées par les thérapies de conversion[7]. Ces chiffres sont très probablement sous-évalués aux vues des moyens financiers importants et du réseau international de ces structures comme : Courage Internationnal, Desert stream living water, Torrent de vie, Exodus Internationnal
L’Allemagne, l’Autriche, Malte, le Brésil, l’Argentine, plusieurs états américains et provinces canadiennes ont déjà interdit ces thérapies, et d’autres pays (la Grande-Bretagne notamment) y songent.[8]
Cet exposé sommaire de la situation montre la nécessité d’en finir avec les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle et affective ou l’identité de genre d’une personne et cela passe par leur interdiction.
Les membres du Grand Conseil soussignés demandent par voie de motion à ce que le Conseil d’État propose une modification législative afin d’interdire les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle et affective ou l’identité de genre d’une personne.
[1] https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/ConversionTherapy_and_HR.aspx
[2] https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Curbing_Deception_world_survey_legal_restrictions_conversion_therapy.pdf
[3] https://360.ch/suisse/55830-la-suisse-refuge-pour-les-adeptes-des-therapies-de-conversion/
[4] https://www.swissinfo.ch/fre/homosexualité_des-groupes-religieux-encouragent-les–thérapies-de-conversion-/44750602
[5] https://360.ch/suisse/19106-les-ex-gays-ont-aussi-leur-reseau-en-suisse/
[6] https://360.ch/suisse/44814-lhomosexualite-un-symptome-a-traiter-selon-un-homeopathe-lausannois/
[7] Émission « Mise au point », RTS, 15 septembre 2019, https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/therapies-de-conversion?urn=urn:rts:video:10710481
[8] Genre: vers une interdiction des thérapies de conversion dévastatrices et trompeuses, Laure Dasinières, Heidi.news, 17 août 2020
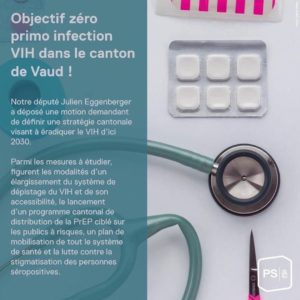 Motion déposée au Grand Conseil du canton de Vaud le 15 décembre 2021
Motion déposée au Grand Conseil du canton de Vaud le 15 décembre 2021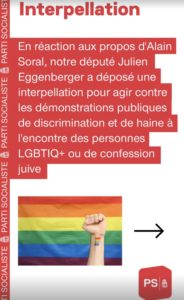 Le 12 septembre, le Matin Dimanche relatait le dernier agissement d’Alain Soral. Ce dernier, résidant dans le canton de Vaud depuis une courte période, a renouvelé des paroles hostiles et dégradantes envers les personnes LGBTIQ+ dans un contexte public, sous la forme d’interventions filmées sur la plateforme de l’organisation Égalité et Réconciliation. Ceci s’ajoute à des prises de position sexistes, racistes ou encore antisémites, par ailleurs régulièrement dénoncées par la CICAD. Par respect pour les personnes, nous renoncerons ici à relayer ces paroles outrancières. Ceci dit, il se trouve que l’article 261bis du Code pénal réprime les appels à la haine et la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle.
Le 12 septembre, le Matin Dimanche relatait le dernier agissement d’Alain Soral. Ce dernier, résidant dans le canton de Vaud depuis une courte période, a renouvelé des paroles hostiles et dégradantes envers les personnes LGBTIQ+ dans un contexte public, sous la forme d’interventions filmées sur la plateforme de l’organisation Égalité et Réconciliation. Ceci s’ajoute à des prises de position sexistes, racistes ou encore antisémites, par ailleurs régulièrement dénoncées par la CICAD. Par respect pour les personnes, nous renoncerons ici à relayer ces paroles outrancières. Ceci dit, il se trouve que l’article 261bis du Code pénal réprime les appels à la haine et la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle.